L’étude a été
réalisée par un étudiant en s’inspirant d’une pompe existante.
SOMMAIRE
I PRESENTATION DE L’ETUDE
II GENERALITES
1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE POMPE HYDRAULIQUE
2. LES POMPES A ENGRENAGES
III PRINCIPE DE LA POMPE ETUDIEE
IV CARACTERISTIQUES DE LA POMPE ETUDIEE
1. FONCTIONNEMENT EN POMPE
HYDRAULIQUE
2. FONCTIONNEMENT EN MOTEUR HYDRAULIQUE
V TRACE DES PROFILS : DEVELOPPANTE DE CERCLE
VI ASSEMBLAGE DE LA POMPE
II GENERALITES
1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE POMPE
HYDRAULIQUE
Les pompes
hydrauliques sont des appareils conçus pour transformer l’énergie mécanique en
énergie hydraulique.
Pendant son fonctionnement l’action mécanique de la
pompe remplit deux fonctions:
-en
premier lieu, elle crée un vide partiel à l’aspiration, ce qui permet à la
pression atmosphérique régnant dans le réservoir d’obliger le liquide à
remonter la canalisation jusqu’à la pompe
-en second
lieu elle assure le transport du liquide jusqu’à l’orifice du refoulement.

Elles se repartissent en trois catégories
principales:
-les
pompes à pistons
-les
pompes à palettes
-les
pompes à engrenages.
2. LES POMPES A ENGRENAGES
Introduction
: Les pompes à engrenages figurent parmi les plus
anciens
systèmes de pompage en hydrostatique.
Les pompes à engrenages sont constituées de pièces
internes en rotation, elles sont de constitution simple, car elles comportent
peu de pièces en mouvement.
Ce sont les pompes les moins chères; toutefois,
leurs performances sont en général sous la moyenne, elles répondent à de très
nombreuses applications dans les secteurs de petites et moyennes puissances.
Elles peuvent fonctionner aussi bien en pompe qu’en
moteur; de plus, elles sont parfaitement réversibles, c’est à dire qu’elles
autorisent la circulation du flux hydraulique dans un sens ou dans l’autre,
selon le sens de rotation de l’arbre.
On distingue deux types d’engrenages:
- Les engrenages à denture
externes.
- Les engrenages à denture
internes.
III PRINCIPE DE LA POMPE ETUDIEE
POMPE A ENGRENAGE EXTERIEUR A JEU AXIAL COMPENSE
Construction de base : (fig. 1)
Les pignons menant 1 et mené 2 sont montés sur des paliers mobiles 8 et 8’ appelés lunettes. L'ensemble pignons et lunettes est adapté à l'intérieur d'un carter 7 et fermé par les flasques 6 et 15. La pression de refoulement est amenée par des canaux internes derrière les lunettes 8 et 8’. Celle-ci agit à l'intérieur de surfaces judicieusement calculées et localisées par des joints plats 9 et 11. Ce système appelé compensation axiale a pour effet de créer des forces F qui rapprochent les lunettes 8 et 8’ sur les flancs de pignons 1 et 2.
Cette technique garantit un jeu latérale minimum et constant dans le temps. Les performances de la pompe sont améliorées et autorisent un fonctionnement continu d'environ 200 bars.
Les fuites de lubrification qui s'écoulent le long des flancs de l'engrenage puis dans les paliers sont ramenées par des canaux internes vers l'aspiration. on dit que la pompe est drainée intérieurement.
La lubrification des alésages des paliers a été réalisée par des rainures Le balayage est renouvelé de cette façon en permanence par de l'huile fraîche pour permettre un graissage optimale des pièces en mouvement.
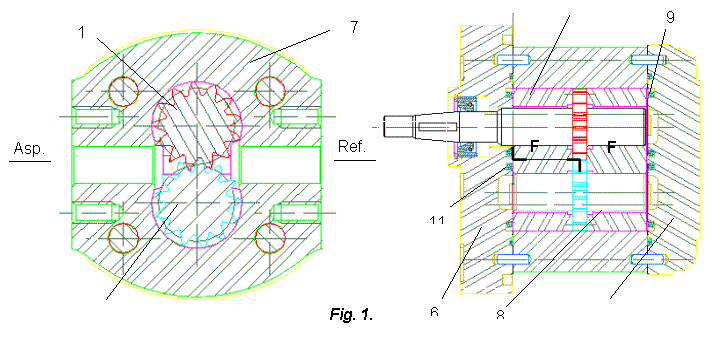
Principe de cylindrée, charges sur paliers (fig.2)
Actionnons par exemple le pignon de droite dans le sens trigonométrique :
- les dents Z1 et Z2 sont en cours de désengrènement et provoquent l'augmentation de l'espace dans la zone 1. C'est la phase aspiration et le fluide issu du réservoir comble l'augmentation de volume ainsi créée ;
- dans un deuxième temps, chaque creux de dents rempli d'huile s'achemine par la périphérie extérieure des pignons vers la zone 2. C'est la phase de transfert;
- les dents Z3 et Z4 sont en cours d'engrènement et provoquent la réduction de l'espace dans la zone 2. C'est la phase refoulement et le fluide issu des creux de dents est chassé vers l'utilisation.
Si l'on mesure la pression qui règne dans les creux de dents, on vérifie que celle-ci augmente progressivement au fur et mesure que l'on s' achemine vers le refoulement. cette remarque nous amène à conclure qu'une charge radiale R s'exerce sur les paliers du côté aspiration. Elle a pour conséquence de provoquer le rabotage des sommets de denture dans le carter côté basse-pression. Cette empreinte de 2 à 3/100 doit être considérée comme normale et n'affecte pas le bon fonctionnement de l'engin.
En actionnant l'engrenage en rotation, on constate que les volumes entre dents X et Y passent successivement par un maximum et un minimum. Théoriquement les volumes sont fermés et provoquent une élévation importante de la pression à cet endroit. Pour atténuer celle-ci on exécute deux encoches e qui décompriment sensiblement le fluide. Toutefois une certaine variation de pression subsiste dont la fréquence dépend du nombre de dents, et du régime de rotation de l'engin.
Z3
Ce phénomène entre
pour une part importante dans le niveau de bruit de la pompe.

Z2
![]()
Fig.
2.
IV CARACTERISTIQUES DE LA POMPE ETUDIEE
Cahier des charges de la
pompe
Caractéristiques
techniques espérées
|
Cylindrée en cm3/tr |
1,2 |
hm = rendement mécanique |
95.2% |
|
Pression maxi en bar |
210 |
hv = rendement volumétrique |
94,5% |
|
vitesse de rotation en tr/min |
6000 |
ht = rendement total |
90% |
(ht = hv * hm)
V = cylindrée (cm3/tr) hm = rendement mécanique
Q = débit (l/min) hv = rendement volumétrique
n = vitesse (tr/min) ht = rendement total
Dp = pression différentiel ( bar)
Estimation
des dimensions

VERIFICATION DES CARACTERISTIQUES
1.FONCTIONNEMENT EN POMPE HYDRAULIQUE
Débit refoulé :
Q = (V . n . hv)/1000 (l/min)
AN : Q = (1,2 . 6000 . 0,945) / 1000
Q = 6,804 l/min
Puissance absorbée :
P = (Dp
. Q)/600 ht (kW)
AN : P = (210 . 6,804)/600 . 0,9
P = 2,646 kW
Couple d’entraînement :
C = (V . Dp)/63 hm
(N.m)
AN : C =
(1,2 . 210)/63 . 0,952
C = 4,2 N.m
2. FONCTIONNEMENT EN MOTEUR HYDRAULIQUE
Débit nécessaire :
Q = (V . n) / 1000 hv (l/min)
AN : Q =
(1,2 . 6000)/1000 . 0,945
Q = 7,619 l/min
Puissance fournie:
P = (Dp . Q . ht) / 600 (kW)
AN : P
= (210 . 7,619 . 0,9)/600
P = 2,399 kW
Couple
fourni:
C = (V .Dp . hm) / 63 (N.m)
AN : C =
(1,2 . 210 . 0,952) / 63
C = 3,8 N.m
V TRACE DES PROFILS :
DEVELOPPANTE DE CERCLE
La développante de cercle est une courbe engendrée par l’extrémité d’une droite qui se déplace sans glissement sur une circonférence. (fig. 2)
A chaque instant de son déplacement, la droite est tangente à la circonférence de base, normale à la courbe et sa longueur augmente constamment jusqu’à ce qu’elle devienne égale au développement de la circonférence.
Pour un moment considéré, la normale étant au point I par exemple, sa longueur est égale à l’espace parcouru sur la partie circulaire comprise entre le point de départ Co ou origine de la développante et le point de tangence I.
C’est à dire :
IC = arc ICo,
I1C1 = arc I1Co,
I2C2 =arc I2Co,etc...
Le
centre instantané de rotation, pour
un point C de la trajectoire, est le
point de contact I, car la tangente IC au cercle de base tourne (pour
l’instant considéré), autour de ce point de contact.

Soit à tracer la développante d’une circonférence C. (fig. 3.)
De l’axe 0A porter, sur la circonférence, un certain nombre de parties égales 1,2,3,...,7 et par les points de division, mener des tangentes en élevant des perpendiculaires aux rayons 01,02,...,07.
Porter sur la première tangente, la longueur du premier arc 1A(en a) ; sur la deuxième tangente, porter deux fois cette longueur (en b), trois fois sur la troisième tangente (en c),etc...
Réunir tous les points a,b;c,etc., par une ligne courbe qui est
la développante.
Calculs relatifs
à la denture d’engrenage
Module de taille : m0
=1,5 (guide du
dessinateur : Série principale : 0,5 ;0,6 ;0,8 ;1 ;1,25 ;1,5 ;2) Coefficient de déport : x1=x2 =0,5 (z < 17)
CONDITION IMPOSEE :
Nombre de dents : z1
= z2 = 13
CONDITION D’ENGRENAGE SANS JEU
a0 = 20°
inv a = inv a0 + 2(x1+x2)/(z1+z2).tg
a0 (inv : involute)
inv
a = tg a1-a 1
(a1
en degrés ; a2 en rd)
inv
a = tg a0 - a0 +2(x1+x2)/(z1+z2).tg a0
inv a = tg 20 - p/9
+2(0,5+0,5)/(13+13).tg20
inv a = 0,043 (cf
tableau)
Angle de
fonctionnement : a =28°
CALCUL DU MODULE DE FONCTIONNEMENT
m.cos
a = m0.cos a0
m =(m0.cos a0)/cos
a
m = (1,5.cos 20)/cos 28
Module de
fonctionnement : m = 1,596
CALCUL DU DIAMETRE PIMITIF DE FONCTIONNEMENT
d = mz
d = 1,596.13
Diamètre
primitif : d = 20.748 mm
CALCUL DU RAYON DE
BASE :
rb = r . cos a
rb = (m.z)/2.cos a
rb =
(1,596.13 /2).cos 28
Rayon de
base : rb = 9,159 mm
CALCUL DU
DIAMETRE DE TETE
da = d0 + 2(1+x).m
da = m0.z + 2(1+x).m
da
= 1,5.13 + 2(1+0,5).1,596
Diametre de
tête : da = 24,288 mm
CALCUL DU
DIAMETRE DE PIED
df = d0 - 2(1,25 - x).m
df = m0.z -2(1,25 - x).m
df
= 1,5.13 -2(1,25 - 0,5).1,596
Diametre de
pied : df = 17,106 mm
CALCUL DE LA LONGUEUR DES SEGMENTS TANGENTS AUX
RAYONS DE BASE
TM = Rb . q Rb : rayon de base
(9,162 mm)
q :
angle de Rb (en radian)
|
q (°) |
q (rd) |
TM (mm) |
|
3 |
p/60 |
0,479 |
|
6 |
p/30 |
0,959 |
|
9 |
p/20 |
1,439 |
|
12 |
p/15 |
1,918 |
|
15 |
p/12 |
2,398 |
|
18 |
p/10 |
2,878 |
|
21 |
7p/60 |
3,358 |
|
24 |
4p/30 |
3,837 |
|
27 |
3p/20 |
4,317 |
|
30 |
p/6 |
4,797 |
|
33 |
11p/60 |
5,276 |
|
36 |
p/5 |
5,756 |
|
39 |
13p/60 |
6,236 |
|
42 |
7p/30 |
6,716 |
|
45 |
p/4 |
7,195 |
|
48 |
8p/30 |
7,675 |
|
51 |
17p/60 |
8,155 |
|
54 |
9p/30 |
8,634 |
|
57 |
19p/60 |
9,114 |
|
60 |
p/3 |
9,594 |
VI ASSEMBLAGE DE LA POMPE
