La betterave  |
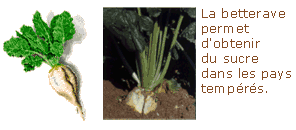 La betterave à
sucre appartient comme l’épinard et la blette à la famille des chénopodiacées. Les
variétés de betterave sucrière cultivées actuellement sont issues de la
betterave " blanche de Silésie " sélectionnée à la fin du
XVIIIème siècle par le chimiste allemand Achard. La betterave à
sucre appartient comme l’épinard et la blette à la famille des chénopodiacées. Les
variétés de betterave sucrière cultivées actuellement sont issues de la
betterave " blanche de Silésie " sélectionnée à la fin du
XVIIIème siècle par le chimiste allemand Achard.
C’est une plante bisannuelle pour sa
reproduction qui s’effectue par graine, mais sa récolte est annuelle. La
première année, elle se développe et constitue ses réserves de sucre dans
la racine. La seconde année elle utilise le sucre en réserve pour se
reproduire.
 La racine
est le " magasin " dans lequel s’accumule le sucre, sous forme
de saccharose. Presque
entièrement enfouie dans le sol, elle mesure entre 15 et 35 cm de long.
Elle est conique, parcourue par deux sillons, et possède un collet plat.
La partie renflée qui contient le plus de sucre se termine par un pivot,
dont le prolongement peut descendre jusqu’à 2 m de profondeur. La racine
est le " magasin " dans lequel s’accumule le sucre, sous forme
de saccharose. Presque
entièrement enfouie dans le sol, elle mesure entre 15 et 35 cm de long.
Elle est conique, parcourue par deux sillons, et possède un collet plat.
La partie renflée qui contient le plus de sucre se termine par un pivot,
dont le prolongement peut descendre jusqu’à 2 m de profondeur.
Ses
feuilles, réparties en bouquet, constituent le laboratoire où se
fabrique le sucre grâce à l’action du soleil sur la chlorophylle (processus de
la photosynthèse).
Ses fleurs,
simples, sans pétales, se dressent en épis à l’extrémité des tiges. Le
fruit, ou glomérule, contient les
graines.
|
|
|
La betterave en
France  |
|
Avant le XIXème siècle :
domination de la canne |
|
Jusqu’au début
du XIXème siècle, c’est la canne,
importée d’Asie puis des îles tropicales, qui fournissait le sucre en
Occident. Cependant on connaissait la betterave sucrière.
|
|
Dès 1575
Olivier de Serres avait signalé dans son Théâtre de l’agriculture
la richesse en sucre de la betterave. |
|
En 1747,
un Allemand, Andreas Sigismund Marggraf, parvient à extraire le
sucre de la betterave. En 1786 son élève Franz Carl Achard construit une
fabrique expérimentale. Plusieurs usines sont édifiées en Silésie et
Bohème, et deux petites sucreries sont fondées dans la région
parisienne. |
|
|
Napoléon et le Blocus
Continental |
|
La Révolution
de 1789 engendre des conflits internationaux qui paralysent le commerce
du sucre, tributaire des transports maritimes. En 1792 la guerre éclate entre les Français et les Anglais. La flotte
britannique empêche les navires marchands venant des colonies d’Amérique
d’arriver dans les ports français. Le sucre est rationné et son prix
atteint dix fois celui d’avant la Révolution. La situation s’aggrave
lorsque l’empereur Napoléon institue le Blocus Continental
qui ferme au commerce de l’Angleterre tous les ports du continent. |
|
En
1812,
Benjamin Delessert réussit à produire le sucre de betterave en
grande quantité. Il présente à Napoléon des pains de sucre aussi blancs
et scintillants que le sucre de canne. Napoléon encourage alors la
production massive de betteraves à sucre. Il distribue un million de
francs aux agriculteurs qui acceptent de pratiquer cette
culture. |
|
|
Après l’Empire |
|
La culture de
la betterave va connaître des hauts et des bas. |
|
En 1890, les
trois cinquièmes du sucre proviennent de la betterave sucrière, mais la
destruction des sucreries du nord de la France pendant la 1ère guerre
mondiale fait chuter la production. |
|
Depuis 1931,
plusieurs conventions ont tenté de fixer des contingents d’exportation
aux pays producteurs. |
|
|
|
La culture de la
betterave  |
|
En France, la
culture de la betterave est concentrée au nord de la Loire. Elle
exige des terres riches, profondes, fortement fumées et préparées, un climat
tempéré assez humide d’avril à septembre. C’est une plante
" nettoyante ", qui favorise le rendement en blé l’année
suivante. On dit que " le sol conserve le souvenir de la
betterave ". |
|
Les semis |
|
On sème les graines au
printemps, après les gelées de mi-mars à fin avril avec des
semoirs de précision. Un binage doit être effectué quelques semaines
après les plantations. Assez fragile, la betterave nécessite des
traitements contre les maladies. |
|
La récolte |
|
La récolte commence en
automne, fin septembre, et doit être terminée en décembre, avant
les grands froids. |
|
Pour arracher les betteraves, on
utilise trois sortes de machines : effeuilleuse ou
décolleteuse, arracheuse, ramasseuse. Des bataillons de camions
transportent les betteraves vers la sucrerie qui est proche des champs,
car avec le temps, les betteraves perdent le sucre qu’elles
contiennent. |
|
Le rendement |
|
Selon les pays on peut récolter de
30 à 90 tonnes de racines à l’hectare. |
|
|
|
Débouchés  |
Le sucre existe déjà dans la
betterave, comme le sel est contenu dans l’eau de mer.
Il s’obtient
au terme d’un travail de séparation : on extrait le sucre
qui existe dans la plante, on le sépare des impuretés, on élimine l’eau. |
| |
|
Les produits dérivés de la
betterave |
| - |
Les
pulpes (partie tendre, riche en éléments nutritifs) servent à
l’alimentation animale. |
| - |
Les feuilles servent à fabriquer de
l’engrais pour les champs. |
| - |
La mélasse (résidu sirupeux de la
cristallisation) sert, entre autre, à fabriquer la levure de
boulangerie. |
| - |
L’alcool sert dans des produits ménagers ou
chimiques.
|
|
|
CHIFFRES-CLES |
|
La France est le
1er producteur mondial de sucre de betteraves devant les USA et
l’Allemagne (4 à 5 millions de tonnes par an) et le 7ème
producteur mondial de sucre. Elle est le 1er exportateur de
l’Union Européenne et le 5ème exportateur
mondial. |
|
La culture des betteraves couvre une
superficie de l’ordre de 2,6% des terres labourables de France, soit 457
000 hectares en 1996-97. |
|
Douze départements situés au nord de
la Loire représentent 90% des surfaces plantées en
betterave. |
|
|
Page extraite du
site : http://www.fermes-ouvertes.fnsea.fr/plantes/betterave.htm |

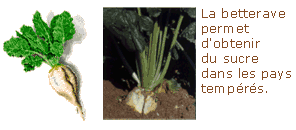 La betterave à
sucre appartient comme l’épinard et la blette à la famille des chénopodiacées. Les
variétés de betterave sucrière cultivées actuellement sont issues de la
betterave " blanche de Silésie " sélectionnée à la fin du
XVIIIème siècle par le chimiste allemand Achard.
La betterave à
sucre appartient comme l’épinard et la blette à la famille des chénopodiacées. Les
variétés de betterave sucrière cultivées actuellement sont issues de la
betterave " blanche de Silésie " sélectionnée à la fin du
XVIIIème siècle par le chimiste allemand Achard.