|
L'acoustique
en conditionnement d'air |
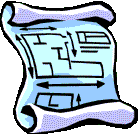 |
|
|
Bruyant ou pas bruyant :
Il faut veiller au respect de la réglementation. En particulier la gène du voisinage par les vibrations et les bruits de condenseurs à air ou tours de refroidissement. Afin d’avoir une idée plus précise à ce sujet, nous allons prendre en exemple l’insonorisation des tours de refroidissement NOTIONS GENERALES Définition du bruit : C’est une sensation auditive désagréable ou gênante produite par un ensemble de sons de fréquence différentes. Il est caractérisé par un niveau de bruit global ou, lorsqu’il est nécessaire d’être plus précis, par son spectre sonore. Mesure du bruit - Sonomètre : Le niveau de bruit global est mesuré à l’aide d’un sonomètre. Cet appareil est constitué principalement d’un microphone, d’un préamplificateur, d’une partie " filtres ", d’un amplificateur, d’un système de détection, d’un affaiblisseur et d’un appareil de lecture. Le microphone transforme l’énergie acoustique reçue sous forme d’une variation de pression en signal électrique qui est ensuite traité dans l’appareil et fait dévier l’aiguille. a) Unité De nombreuses expériences ont montré que la sensation auditive n’est pas directement proportionnelle à la variation de pression mais à son logarithme. L’unité choisie pour mesurer la sensation auditive est le Bel ou plus précisément le décibel, qui correspond pratiquement à la plus petite variation de " bruit " que l’oreille humaine peut discerner. Par convention internationale le niveau de pression sonore d’un bruit Np exprimé en décibel est égal à :
Np = 20 log P/(2.10-4 barye)
Une différence de bruit de 1 dB correspond à une augmentation de la pression sonore de 12%. Une différence de bruit de 3 dB est juste discernable, de 5 dB est clairement perçue, de 10 dB donne la sensation d’un bruit 2 fois plus grand. c) Courbes de pondération A, B, C Etant donné que la réponse de l’oreille varie en fonction de la fréquence, on a inventé des courbes de pondération appelées A ou B ou C, pour essayer de mieux représenter ce que l’oreille entend.
On mesure alors des niveaux de pression acoustique pondérés exprimés en décibels et en mentionnant la courbe de pondération utilisée (par exemple dBA si la courbe de pondération choisie est la courbe A. La pondération consiste à retrancher à chaque composante de la pression acoustique aux différentes fréquences les valeurs figurant dans le tableau précédent. Cette opération est faite automatiquement dans le sonomètre qui donne directement la mesure en dB(A), ou dB(B), ou dB(C). d) Spectre sonore Le niveau de bruit global n’est pas suffisant pour caractériser un bruit. En particulier quand on veut abaisser le bruit d’un appareil, on relève le spectre sonore du bruit émis. On mesure le niveau de pression sonore dans chaque octave (ou ½ octave, ou 1/3 d’octave). Un octave est une bande de fréquence telle qu’il existe un rapport 2/1 entre les fréquences limites supérieure et inférieure. Par exemple, la bande de fréquence comprise entre 70 et 140 Hz constitue un octave. La fréquence médiane est la moyenne géométrique des fréquences limites :
(exemple
: pour l’octave 70-140 Hz : La plage des fréquences audibles a été divisée en neuf octaves normalisés dont les fréquences moyennes sont : 31,5 - 63 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - et 8000 Hz Le relevé du spectre sonore est réalisé à l’aide d’un sonomètre complété d’un ensemble de filtres qui ne laissent passer chacun qu’un octave. En ajoutant tous les niveaux de pression sonore du spectre on obtient le niveau de bruit global. e) Règle d’addition La somme d’un bruit de 60 dB et d’un bruit de 65 dB n’est pas un bruit de 125 dB ! Pour additionner on utilise la règle suivante :
Au delà de 10 dB d’écart, le bruit le plus faible n’a plus aucune influence. Ainsi dans l’exemple ci-dessus les deux bruit différent de 5 dB. Il faut donc ajouter au plus grand 1,2 dB soit 65 + 1,2 = 66,2 dB. Pour additionner plusieurs bruits on opère de proche en proche. On fait la somme des deux premiers à quoi on ajoute le troisième ..etc..
Deux bruits d’égal niveau de pression global provoquent à l’oreille des sensations auditives différentes selon leur constitution, c’est à dire suivant l’aspect de leur spectre sonore. C’est pourquoi, pour permettre de mesurer la gêne engendrée par un bruit, une échelle a été définie dans chaque octave normalisé. L’ensemble se présente sous la forme d’un réseau de courbes appelées NR (Noise Rating) numérotées de 0 à 120. L’indice d’évaluation de la gêne due à un bruit est le numéro de la courbe NR situé immédiatement au dessus de tous les points du spectre sonore (NR 83 sur l’exemple ci-dessus) Avant l’adoption des courbes NR, il existait un réseau d’évaluation appelé NC (Noise Critéria), quelque peu différent de réseau NR. Il est très peu utilisé actuellement en Europe. A titre d’exemple, nous avons tracé sur le même graphique les courbes NR 30 et NR 60 ainsi que NC 30 et NC 60. NOTA : Les courbes NR sont celles de la recommandation ISO/R 1996
Relation entre les courbes NR et niveau de bruit global en dB(A, B, ou C) Examinons toujours la figure précédente ; le spectre sonore correspond aux valeurs du tableau 2. Pour obtenir les niveaux de pression sonore globaux on fait la somme de tous les niveaux de pression de chaque bande d’un octave et on trouve les valeurs de la dernière ligne. Exemple :
On voit donc qu’un bruit de 112 dB et un bruit de 91 dB occasionnent la même gêne évaluée par l’indice NR 83. Répétons la même opération en utilisant la courbe de pondération A Les deux bruits de 89,6 et 86,7 dB(A) ont toujours même indice de gêne : NR 83. Autrement dit, il n’y a pas de correspondance directe entre l’indice NR et le niveau de bruit global, qu’il soit exprimé en dB(A) ou dB(B) ou dB(C); le niveau de bruit global dépend de la répartition de l’énergie sonore dans la plage des fréquences audibles.
On peut les classer en trois catégories : - à la sortie des " éclateurs " (ou autres dispositifs dont le rôle est de diviser l’eau), - à la partie supérieure du corps d’échange lors de l’impact, - à la surface de l’eau de bassin de réception (bruit de chute d’eau). b) les bruits d’air : Toute turbulence est associée à l’émission d’un bruit. C’est le cas en particulier : - dans le ventilateur, - dans le plénum sous le corps d’échange, - dans le corps d’échange lui-même, - dans le séparateur de gouttes. c) les bruits mécaniques - le moteur électrique, - la transmission, - les roulements à billes, les vibration des tôles. Nous ne tenons pas compte des bruits qui peuvent provenir de tuyauteries de diamètre insuffisant - dans lesquelles le bruit de circulation de l’eau est important - ou mal isolés, transmettant alors les vibrations et les bruits dus à la pompe de circulation.
Les constructeurs indiquent souvent dans leur documentation, le niveau de bruit global émis, par chaque type de tour à une distance déterminée (20 m par exemple) et dans deux directions perpendiculaires. Sont également disponibles les spectres sonores à des distances de 2 et 20 m. Les renseignements fournis sont issus d’essais réalisés sur un seul modèle de tour puis extrapolés à l’ensemble de la gamme conformément aux lois d’extrapolation couramment admises en ce domaine.
La tour en essai était posée au sol, relativement éloignée des bâtiments : la nature du sol, la proximité des bâtiments modifient la valeur des relevés. La précision du sonomètre utilisé est de +/- 2 dB. L’émission du bruit présente une directivité certaine; le bruit est plus élevé côté ventilateurs et dans la direction verticale ascendante.
Les réfrigérants d’eau sont dans l’immense majorité des cas, installés à l’extérieur des locaux; ils prennent l’air et le refoulent directement à l’atmosphère. Le bruit occasionné par nos tours de refroidissement, bien que réputé faible, peut toutefois gêner les personnes qui vivent ou travaillent dans le voisinage. Pour savoir s’il est nécessaire ou non d’insonoriser la tour de refroidissement, on se fixe le niveau de bruit admissible dans le local considéré (voir tableau). Supposons une salle de restaurant où l’on se fixe un niveau de bruit admissible NR 40. Cela signifie qu’en l’absence de toute source de bruit intérieure, le bruit pénétrant dans le local à travers la paroi ne doit pas dépasser pour chaque fréquence normalisée la valeur de la courbe NR 40. Le bruit entrant est calculé en ajoutant au bruit de la tour le bruit de l’ambiance extérieure et en soustrayant la réduction de bruit due à la traversée de la paroi. Les résultats sont récapitulés dans une note de calcul suivant le modèle suivant :
Interprétation des calculs - Si toutes les valeurs de la ligne 7 sont positives ou nulles, la condition NR 40 est absolument respectée. - Si pour 2 ou 3 octaves le bruit entrant est supérieure de 1 à 3 dB à la valeur correspondante de NR 40, il n’y aura probablement pas de problème de gêne due à la tour. - Si pour plus de 2 octaves le bruit entrant est supérieure de 5 dB (ou plus) à la valeur correspondante de NR 40 il y aura une gêne et il est nécessaire de prévoir une réduction du bruit de la tour. POSSIBILITES DE REDUIRE LE NIVEAU DE BRUIT 1 - L’éloignement : Le bruit diminue de façon considérable quand la distance à la source augmente. Dans les conditions idéales (source ponctuelle, émission uniforme dans toutes les directions, absorption égale pour toutes les fréquences) la différence des bruits perçus quand on passe de la distance d0 à la distance di peut s’écrire :
par exemple lorsque la distance à la source double (di/do = 2) le niveau de pression sonore diminue de 20 log 2 = 6 dB. On cherchera donc toujours à installer la tour aussi loin que possible des zones où le bruit risquerait d’être gênant. 2 -L’orientation : Le bruit émis étant plus important face aux ventilateurs, on orientera la tour de façon à ce qu’elle soit vue de côté, ou de l’arrière pour une tour simple, depuis les endroits où le bruit peut être gênant. Ces deux premières possibilités sont gratuites, elles n’entraînent aucun coût supplémentaire. 3 -L’écran : Pour être efficace, il faut respecter les conditions suivantes : - couvrir au moins toute la section apparente de la tour et même davantage (1 à 1,5 m au-delà en hauteur et en largeur), - ne présenter aucune ouverture, - être situé le plus près possible tout en respectant nos prescriptions pour que l’arrivée d’air ne soit pas rendue difficile - être assez lourd (plus de 10 kg/m²). Moyennant quoi on peut escompter un amortissement de 6 à 7 dB. 4 - Le moteur à deux vitesses : Généralement les réfrigérants d’eau sont sélectionnés pour les conditions maximales d’utilisation : pleine puissance à évacuer et bulbe humide de l’air maximum. Il arrive fréquemment que la puissance à évacuer varie durant le fonctionnement (variation suivant un cycle de fabrication dans l’industrie, variation des apports thermiques dans le domaine du conditionnement d’air...). En outre, le bulbe humide maximum ne se présente que durant un faible nombre d’heures chaque année. Le bulbe humide annuel moyen est de beaucoup inférieur à celui qui est adopté pour le calcul de la tout de refroidissement. Dans les deux cas (puissance thermique qui diminue, ou/et bulbe humide réel plus faible) la tour de refroidissement se trouve surdimensionnée; il faut alors moins d’air pour obtenir le refroidissement désiré. Si la tour est équipée d’un moteur à deux vitesses, elle pourra fonctionner en demi-vitesses, elle pourra fonctionner en demi-vitesse durant un grand nombre d’heures chaque année. Si le bruit émis par la tour à sa vitesse nominale risque de poser un problème, celui-ci peut être solutionné durant tout le temps où la tour fonctionne à demi-vitesse : la différence de bruit entre pleine et demi-vitesse est de 6 à 7 dB. La différence de prix entre le moteur à une seule vitesse et le moteur à deux vitesses est rapidement remboursée par les économies d’énergie réalisées. Exemple : Considérons une tour de type XYZ équipée d’un moteur une vitesse 1500 t/mn de 9 kW, qui consomme 11 kW d’une part et la même tour équipée d’un moteur deux vitesses (1500/750 t/mn) de 9,6/1,9 kW qui consomme 2,0 kW à la petite vitesse d’autre part. Chaque heure de fonctionnement à la petite vitesse entraîne une économie de 7 kWh. Dans cet exemple, l’investissement du moteur 2 vitesses est remboursé au bout de 250 heures de fonctionnement à charge partielle. Il est toutefois plus difficile de déterminer à l’avance le temps d’amortissement en mois. Il dépend essentiellement de la puissance thermique réelle à évacuer, de sa variation diurne et saisonnière, des conditions climatiques de l’endroit, etc. L’expérience montre que la différence de prix entre le moteur à une seule vitesse et le moteur à deux vitesses est rapidement réalisées. 5 - Le déclassement : L’exemple qui précède montre qu’il faut toujours préconiser l’utilisation d’un moteur à deux vitesses, même en l’absence de tout problème de bruit Les économies d’énergie réalisées le justifient amplement. Cependant, lorsque le bruit doit être limité, en toutes circonstances la rotation, même épisodique, des ventilateurs à pleine vitesse n’est pas acceptable. L’idée vient alors de faire tourner les ventilateurs moins vite pour avoir moins de bruit ce qui conduit dans les mêmes conditions thermiques à choisir un matériel plus grand. Marche à suivre : - sur l’abaque de sélection des tours on positionne le point M représentatif de la tour théoriquement " juste " nécessaire. Ce point M est généralement situé entre deux modèles de la gamme : A et B. Au lieu de choisir le modèle B comme le veut la pratique normale, on choisit le modèle C ou D... Supposons que l’on ait choisi C. Le débit d’eau qu’il peut refroidir est Q1. A l’inverse le rapport (Q/Q1 x 100%) peut être appelé coefficient d’utilisation de la tour C. On reporte sur l’abaque Fig. 9 la valeur du coefficient d’utilisation sur l’échelle correspondante. Une horizontale tracée par ce point permet de lire sur les autres échelles : - Le débit d’air nécessaire, - La réduction du bruit par rapport aux conditions nominales d’utilisation. Cette valeur est à retrancher du niveau de bruit de la tour C indiqué dans les documentations. - La puissance électrique absorbée pour ce débit d’air, ce qui permet de choisir le moteur électrique et de calculer l’économie. En résumé, ce moyen pour diminuer le bruit entraîne des avantages appréciables : consommation électrique plus faible, vitesse de rotation des ventilateurs réduite, augmentation de la puissance facile à réaliser en cas d’augmentation des besoins. Exemple : Supposons une tour définie sur l’abaque de sélection par un coefficient de température de 20 et un débit d’eau à refroidir de 95 m3/h. La sélection classique conduit à une tour modèle 42-S. Niveau de bruit catalogue : 57 dB(A) Si ce niveau de bruit est jugé trop élevé, nous avons plusieurs possibilités, résumées dans le tableau ci-après. On peut donc observer que le prix du déclassement est remboursé dans un temps relativement bref (9600h de fonctionnement pour une réduction de bruit de 6 dB par rapport à la tour standard). Dans tous les cas où le niveau de bruit imposé le permet, il faut préférer les solutions précédentes (éloignement, orientation, déclassement ...) parce qu’elles sont gratuites et même elles apportent après amortissement, des bénéfices sur la consommation d’énergie. Ces solutions sont également applicables aux réfrigérants d’eau équipés de ventilateurs hélicoïdes, qui ne peuvent délivrer davantage de pression à l’air et que l’on ne peut donc pas " insonoriser " autrement. Au contraire, les solutions décrites dans la suite entraînent, et un supplément de prix à l’achat et un supplément de consommation d’énergie.
- Le niveau sonore ligne 3 s’entend à 20m côté ventilateur idem ligne 7 - La durée d’amortissement est obtenue en divisant le surcoût des différentes solutions par l’économie réalisée sur chaque heure de fonctionnement. - L’économie horaire en kW/h est obtenue par différence avec la sélection standard, colonne 1. - La tour 42-S standard a été admise sans modification bien qu’à la limite on aurait pu diminuer le débit d’air et la puissance du moteur électrique puisqu’elle est capable de refroidir 101 m3/h (coefficient d’utilisation 0,94).
Une part importante du bruit émis par une tour de refroidissement est véhiculée par le flux d’air qui la traverse. On essaie donc d’empêcher le bruit de sortir de la tour au moyen de silencieux. Il en existe divers modèles, mais les plus couramment rencontrés sont constitués de baffles disposés à intervalles réguliers à l’intérieur d’un tronçon de gaine, parallèlement au sens de circulation de l’air (voir figure ci-contre). Les baffles sont véritablement les éléments qui absorbent le bruit. Ils comportent un cadre en tôle d’acier galvanisée à l’intérieur duquel se trouve emprisonné un matelas de laine de verre. Les faces extérieures du matelas en contact avec l’air humide et soumises aux intempéries, sont spécialement traitées pour ces conditions. L’atténuation du bruit est proportionnée à la longueur et au rapport (périmètre/surface) de la section de passage de l’air. Elle dépend également de la fréquence. De nombreux essais ont été réalisés sur une tour 21S et nous ont conduit à retenir les proportions ci-après : - une épaisseur de baffle unique : 200 mm - deux longueurs de baffle (dimension dans le sens de circulation de l’air) ; 600 et 1200 mm. Les essais ont confirmé que le niveau de bruit n’est pas identique sur la face où se trouvent le(s) ventilateurs(s). Tous les chiffres avancés dans la suite du texte s’entendent à une distance de 20 m de la tour; face au(x) ventilateur(s). a) - La tour sélectionnée est équipée d’un silencieux avec baffles de 600 mm de longueur sur l’entrée d’air seulement. On abaisse ainsi le bruit à NR 47. C’est équivalent à un déclassement de 25% (coefficient d’utilisation de 75%). b) - La tour sélectionnée est équipée d’un silencieux avec baffles de 1200 mm de longueur sur l’entrée d’air seule. c) - On choisit une tour surdimensionnée (coefficient d’utilisation 75% maximum) équipée d’un silencieux avec baffles de 1200 mm de longueur à l’entrée d’air seulement. On obtient NR 40. d) - La tour sélectionnée est équipée d’un silencieux avec baffles de 600 mm de longueur à l’aspiration et au refoulement. On obtient également NR 40 (variante à la proposition précédente). e) - La tour sélectionnée est équipée d’un silencieux avec baffles de 1200 mm à l’entrée de l’air et d’un silencieux avec baffles de 600 mm au refoulement. On obtient NR 36 Dans les deux derniers cas, où il y a un silencieux au refoulement, une légère modification a dû être apportée à la tour pour permettre l’accès à l’intérieur par le dessous. Le séparateur de gouttes standard en acier, lourd et peu maniable, est remplacé par un séparateur en PVC léger, de dimensions unitaires plus petites et facilement amovible. Il suffit donc de retirer quelques baffles pour pouvoir sortir le séparateur de gouttes et accéder à l’intérieur de la tour (éclateurs, herse, corps de remplissage...).
courbes de la page 21
Le tableau suivant donne une vue d’ensemble des différentes solutions disponibles. On trouvera sur les courbes de la page précédente un exemple de spectres sonores relevés sur une tour 21S, correspondant aux variantes dans les colonnes 1,5,7 et 8. Outre les niveaux de bruit indiqués dans les documents technico-commerciaux, les clients du constructeur de ces tours, peuvent également obtenir les spectres sonores des tours de refroidissement non équipées d’atténuateurs, les spectres d’amortissement moyens des pièges à son de 600 et 1200 mm et une table d’encombrement et de poids des équipements proposés. Récapitulation des diverses possibilités de réduction du bruit
- La solution de la colonne 3 n’a aucun intérêt; elle est légèrement moins chère mais consomme davantage de kW que la solution 2. - Les solutions des colonnes 4 et 6 sont respectivement plus chères que 5 et 7, mais elles offrent deux avantages de poids: (1) - la consommation électrique est nettement plus faible: différence de 9 kW entre 4 et 5 ; de 5,6 kW entre 6 et 7, (2) - l’accès à la partie supérieure de la tour (distribution d’eau, corps d’échange...) est aisé puisqu’il n’y a aucun équipement au refoulement de la tour. Ceci est très appréciable lors des visites et interventions d’entretien. Conclusions : Cette étude n’a pas pour objet de permettre de résoudre les problèmes d’environnement sonore qui pourraient se poser aux utilisateurs de réfrigérateurs d’eau. C’est une affaire de spécialistes acousticiens. La tour de refroidissement sera installée dans une ambiance donnée, à proximité de locaux, d’autres machines; les problèmes de bruit peuvent se superposer à des problèmes de vibration, de résonance, etc..); Pour les raisons qui précèdent, chaque cas d’installation est un cas particulier, différent des conditions dans lesquelles ont été réalisés les essais. C’est pourquoi les chiffres indiqués ici ne peuvent être manipulés qu’avec une extrême prudence.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
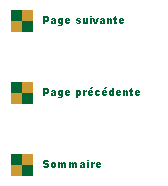
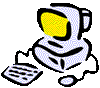
|
|
||
|
Sommaire | Haut de cette page | Pour commander |
||
|
|
||
|
|
||