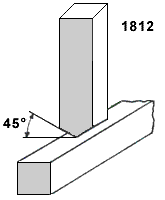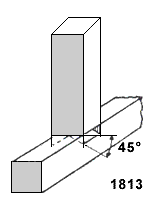5. SOUDOBRASAGE DES FERS ET PROFILES
Le soudobrasage est bien adapté à de tels assemblages car il présente sur le soudage autogène des avantages marqués, le soudage au chalumeau est, dans ces cas d'un emploi délicat, car, l'échauffement relatif important des abords de l'assemblage est de nature à provoquer des déformations génantes au refroidissement, l'exécution est, par ailleurs ralentie ou compliquée par les risques d'effondrement du métal liquide et les difficultés de bien placer le métal d'apport au début et en fin d'opération (cordons irréguliers).
5.1. Assemblage de fers carrés
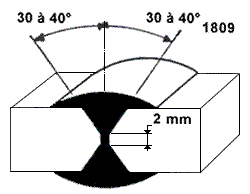
5.1.1. Fers carrés "bout à bout"
Schéma 1809, les extrémités doivent être chanfreinées autant que possible à 90° en X, avec un faible méplat central (environ 2 mm) et les angles étant abattus, le chanfein en V est moins indiqué parceque moins économique. L'exécution ne comporte pas de difficultés surtout s'il est possible d'alterner les dépôts de métal par passes relativement minces au recto, puis au verso, afin d'éviter une surchauffe localisée avec risques de décollement.
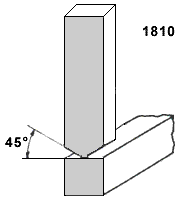 |
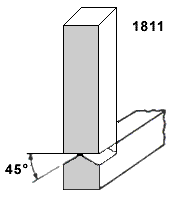 |
5.1.2. Fers carrés "en équerre"
Schémas 1810 et 1811, l'un des éléments doit être préparé en double chanfrein à 45°, avec méplat au centre, deux solutions sont possibles :
- solution 1
- schéma 1810, qui parait la plus simple, a l'inconvénient, comme dans le cas précédent, de nécessiter une forte réduction de la chauffe pendant l'exécution proprement dite, sinon le métal d'apport non maintenu aux deux extrémités de chaque demi-chanfrein, aurait tendance à s'écouler, notamment vers l'angle intérieur de l'équerre où l'échauffement a tendance à être maximum.
- schéma 1811, qui nécessite une entaille en chanfrein femelle en X, d'ailleurs facile a réaliser et présente un avantage évident : au contact des deux éléments, l'espace libre constitue un double moule fermé vers l'intérieur de l'angle, donc susceptible de bien maintenir le métal d'apport liquide avec un minimum de risque de "coulure".
- solution 2
5.1.3.Fers carrés "en T"
Schémas 1812 et 1813, ce type d'assemblage est une variante du précédent "en équerre", l'un des deux éléments doit être préparé en X, toujours pour des raisons d'économie de métal d'apport, deux solutions sont possibles :
- solution 1
- schéma 1812, c'est une préparation simple, mais qui réalise un maintien imparfait du métal d'apport, elle oblige à une exécution attentive et lente pour éviter les risques de "coulure".
- schéma 1813, d'exécution un peu plus délicate, donc plus onéreuse ; mais elle fournit un maintien idéal du métal d'apport liquide, il est alors possible d'utiliser la flamme puissante, utilisée en préchauffe, pendant toute l'exécution, d'où une compensation efficace des frais supplémentaires de préparation, à laquelle il convient d'ajouter la suppression d'un ébarbage éventuel du cordon après l'opération.
- solution 2
5.2. Assemblage de fers ronds
5.2.1. Fers ronds "bout à bout"
Schéma 1814, ces assemblages de "raboutage" peuvent être réalisés par soudobrasage après une préparation analogue à celle précisée pour les fers carrés, le mode opératoire est le même, mais l'exécution est facilité par la forme des éléments.
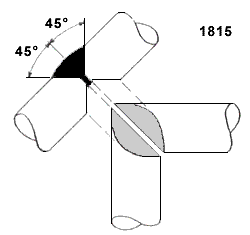
5.2.2. Fers ronds "en équerre"
Schéma 1815, la seule préparation vraiment adaptée aux fers ronds est celle d'éléments chanfreinés en X à partir de coupes "en onglet" à 45°. Elle permet un assemblage esthétique, d'exécution particulièrement facile et surtout relativement économique (chauffe réduite, et dépenses modérées de métal d'apport).
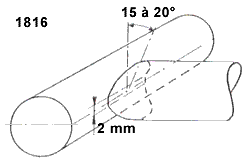
5.2.3. Fers ronds "en T"
Schéma 1816, la préparation la plus simple et la mieux adaptée consiste à chanfreiner en X l'élément venant en bout, l'angle peut être faible (15 à 20°) compte tenu du dégagement procuré par la surface circulaire de l'autre élément.
5.3. Assemblage des tubes
Le soudobrasage est particulièrement bien adapté à l'assemblage de tubes de toutes dimensions et d'épaisseurs, et il convient d'y penser chaque fois que les conditions de service n'imposent pas des caractéristiques mécaniques exceptionnelles, la possibilité d'opérer en toutes positions, plus rapidement qu'en soudage autogène, avec d'excellentes garanties d'étanchéités explique à elle seule la préférence des utilisateurs pour ce procédé en matière de réalisation de réseaux de canalisations les plus diverses, qu'il s'agisse de tubes courants en acier doux, dits "tubes noirs " ou, au contraire de tubes galvanisés pour éviter la corrosion.
Quels que soient les types d'assemblage envisagés, un soudobrasge correct ne peut être réalisé qu'à partir de surfaces préalablement dégraissées et décalaminées ; les tubes étirés à froid ne sont pas calaminés mais il n'en est pas de même des tubes "chauffage" qui doivent subir un décapage convenable des surfaces voisines du joint (limage, meulage, etc..)
Raboutage : pour les diamètres les plus courants de 15/21 à 40/49, les raboutages sont a exécuter de préférence à partir d'éléments débités selon une section droite, à la "scie", sans aucun chanfrein complémentaire, les épaisseurs sont, en effet suffisamment faibles pour permettre, en cours de travail, une pénétration suffisante du métal d'apport liquide dans le joint.
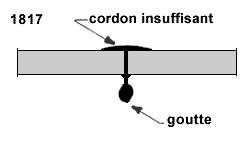
Au regard du schéma 1817, afin d'éviter la formation de grosses gouttes qui entraveraient la circulation du fluide dans la tuyauterie, il est recommandé d'utiliser un chauffage volontairement réduit pour assurer le bon "mouillage du joint"
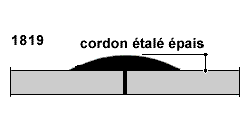
Au regard du schéma 1819, ce processus peut entraîner des manques de pénétration, mais les risques que comporteraient ces défauts quant à la résistance d'ensemble peuvent être compensés aisément par la réalisation d'un cordon extérieur largement étalé de part et d'autre du joint et aussi épais que nécessaire.
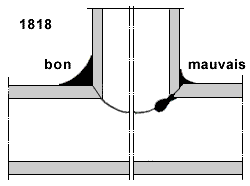
Piquage en "T", schéma 1818, dans la limite des diamètres déjà définis, et pour des éléments de même diamètre, il est recommandé de ne prévoir aucun chanfreinage des bords en contact, les préparation en "gueule de loup" nécessaire pour l'assemblage de tubes de diamètres identiques peuvent être obtenus par sciage, meulage, fraisage, limage, etc... des éléments, un ajustement complémentaire étant souvent nécessaire pour assurer un contact régulier sur tout le périmètre du joint, des jeux localisés excessifs risqueraient de faciliter des "coulures" de métal d'apport à l'intérieur, avec formation de grosses gouttes.
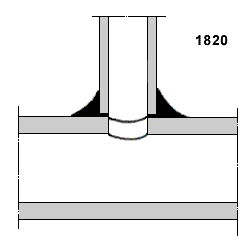
Lorsqu'il s'agit d'assembler des diamètres très différents schéma 1820, la préparation peut être encore simplifiée, le petit tube est alors coupé droit et présenté directement sur le gros tube, simplement percé d'un trou de diamètre égal à l'alésage du petit tube.