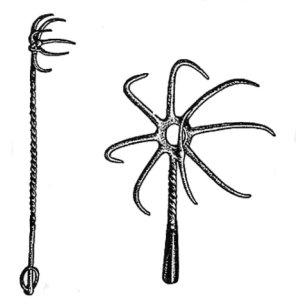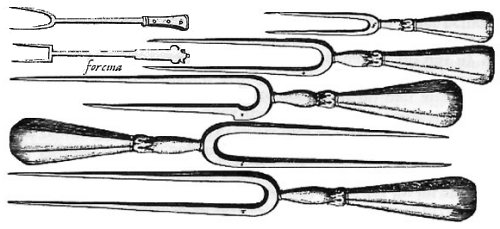|
LA
FOURCHETTE
( Richard Bit
)
7 mars 2002
Introduction
Après notre brève étude de la cuillère,
parue dans un article précédent, nous allons cette fois étudier la
fourchette (vous aurez sans doute deviné que l’étude du couteau est
en cours).
Comme nous avons déjà retracé l’historique des
couverts et insisté sur le fait que la fabrication artisanale
rendait difficile la classification et la datation, nous nous
bornerons à présenter ce qui nous semble être les principaux types
de fourchettes et les datations qui peuvent s’y rapporter (notre
inventaire sera donc fort incomplet).
Il est évident que la forme
la plus naturelle de la fourchette est celle du père Adam. En effet,
on mangeait encore avec ses doigts au début du XXème s. Cette
méthode est d’ailleurs toujours utilisée dans certaines régions
(pour des raisons économiques, culturelles ou religieuses) mais même
chez nous cet usage est de mise en certaines circonstances pour des
mets particuliers. Il est tout aussi évident que de simples
bâtonnets ou des os appointés ont pu faire office de fourchette
lorsque leur rôle était de maintenir la nourriture ou de la porter à
la bouche. Certains types de couteaux ont d’ailleurs servi à rendre
le même service. Par la force des choses ces objets ne feront pas
partie de notre étude.
Définitions de la
fourchette
- Ustensile
en forme de petite fourche dont on se sert pour saisir différents
mets et les porter à la bouche ou les assujettir pour les découper.
- Ustensile de table en forme de petite fourche à deux, trois ou
quatre dents.
Remarque : il est évident que la forme et les
dimensions de la fourchette se sont adaptées aux divers usages que
l’on voulait en faire.
Étymologie : de fourche (du latin
furca)
Historique
L’archéologie témoigne de ce que les
Égyptiens tout comme les Romains se servaient de crocs pour saisir
les morceaux de viande dans les chaudrons. L'utilisation de ces
ancêtres de la fourchette était donc apparemment plutôt réservée à
la cuisine qu'à la table.
En ce qui concerne l'origine de la
fourchette en tant que couvert, il faut bien constater que les
historiens n’ont pas réussi à se mettre d'accord. En la matière, la
seule certitude, quant à son apparition, est qu'elle est postérieure
au couteau et à la cuillère.
Il est communément admis que la
fourchette serait apparue au XIème s. en Italie où elle servait à
déguster les fruits. Plus tard, on l'utilisa comme fourchette à feu
ou à pot.
Longtemps considérée comme un objet "maudit" à cause de
sa forme soit disant satanique, la fourchette ne fut que tardivement
utilisée comme véritable couvert de table. Elle s'implanta surtout à
partir du XVIème s., mais encore au XVIIème s., elle était
essentiellement un objet de luxe.
Voyons avec un peu plus de
détails ce que les historiens ont retenu à propos de son
évolution.
a) Pour certains, la première à s'en
servir serait une princesse byzantine, sœur de l'empereur Argile,
qui vivait à la fin du XIème s.
A Venise, elle aurait épousé le
fils du doge Pietro Arscolo (Domenico Silvio ?). C'est là qu'elle
utilisa sa fourchette en or (à deux dents) qu’elle conservait dans
un étui en cuir. Comme cela fit sensation, le doge en commanda pour
sa famille et toute sa Cour. A l’époque, la dogaresse fit scandale
car cette nouveauté fut considérée comme un manque de raffinement et
les ecclésiastiques attirèrent sur elle le «courroux divin» !
(référence à la fourche, connotation négative = fourche, enfer,
pendaison, fourches caudines, etc … ).
Un peu plus tard, on
trouve une fourchette mentionnée dans l'inventaire (1328) de la
reine de Hongrie. Sans doute ne s’en servit-elle pas car durant tout
le Moyen Âge on n'utilisa ces ustensiles que pour piquer les viandes
et parfois pour la dégustation de fruits confits.
L'inventaire
des joyaux du roi Charles V (21 janvier 1379) fait également mention
d'un certain nombre de fourchettes en or, de différents
modèles.
Il n’empêche qu’à la fin du XIVème s., on portait
toujours les morceaux à la bouche avec les doigts.
De Venise, la
fourchette parvint à Florence et de là en France. Cependant, la
reine de France, Catherine de Médicis (1519-1589), ne semblait pas
en être une fervente adepte.
A partir du XVIème s., la
fourchette s’implanta en Angleterre et en Allemagne, du moins dans
les couches sociales supérieures. Au début, elle servait à prendre
les mets dans le plat commun.
b) Pour d'autres, l'usage des
fourchettes s'est répandu sous Henri III. On prétend, que c’est lors
de son retour de Pologne, que passant par Venise, il redécouvrit la
fourchette et s'en engoua. La mode des collerettes géantes (les
fraises) favorisa indirectement l'usage des fourchettes vénitiennes
aux deux longues dents pointues car elles permettaient d'effectuer
le trajet du plat à la bouche sans salir l'encombrant ornement
vestimentaire. Ce serait au "restaurant" de la Tour d'Argent que la
fourchette apparut « en public » pour la première fois. Cette
innovation suscita bien des moqueries car on la trouva ridicule et
encombrante, l'utilisation des doigts étant jugée bien plus
pratique.
Quoi qu’il en soit, il faut attendre la fin du
XVIIème s. pour que la fourchette à quatre dents (et non plus deux),
telle que nous l’utilisons communément à l’heure actuelle, commence
à faire partie des usages. Elle restait encore essentiellement un
objet de luxe et les ignorants, qui en méconnaissaient l'usage, s'en
servaient comme cure-dent !
Rappelons que Louis XIV (1638-1715),
même s'il était une "bonne fourchette", mangeait toujours avec les
doigts.
Inventaire et
datation
|
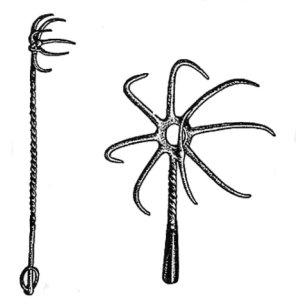
crocs d’époque romaine («
harpago ») |

fourchette
romaine |
|

Fourchette-brochette de
cuisine, fer, XVe s., coll.
BMG |
|
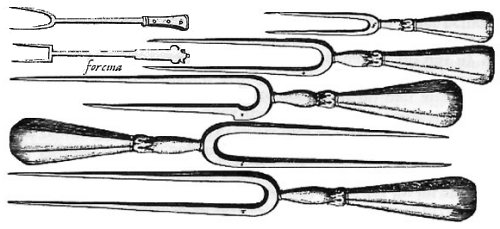
En haut, à gauche : croquis
de 2 fourchettes utilisées par la cuisinier du Pape Pie V
(XVIe s.)
A droite et dessous : fourchettes de cuisine du
XVIIe s. |
|

Fourchette de cuisine, fer
et manche en bois, circa 1880, coll.
BMG |
|

Fourchette de table, argent
massif, aux armes du Maréchal Mobutu, XXe s., coll.
BMG

Fourchette-cuillère de
réception, métal inaltérable 18/10, Debergh, 1999. Coll.
BMG |
|
|
BIBLIOGRAPHIE.
Pierre Andrieu - "L'art de la Table",
éd. Albin Michel, Paris 1961, 251 pp.
"A table... les
Français!" in Historia, hors série n° 42, Paris 1975, 128pp.
; André Castelot - "Mettez le couvert", in Les Français à table
depuis 2000 ans, pp. 9-17
La table et le couvert, TDC/
438 pp.8-10 (Françoise Zonabend, « La mémoire longue » PUF, 1980 ;
Barbara Ketcham « L’office et la bouche », Calmann-Levy,1983 ;
Norbert Elias).
Archéologie suisse, 8.1985.3, pp.118-228
(Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frügeschischte,
Basel) |